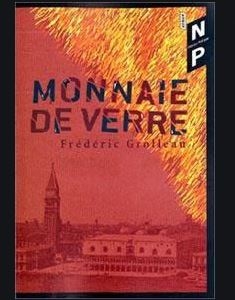 Venise – plus exactement Murano – , à la fin du XVIIe siècle ; voilà pour le décor et l’époque. L’intrigue, maintenant : une jeune fille – belle et intrépide, comme il sied à une héroïne – dérobe par vengeance à son maître-verrier de père les précieuses formules dont dépend la qualité de ses productions. Il faut dire que l’auguste patriarche avait ordonné à ses trois fils d’assassiner l’amant de sa fille. Rivalité entre familles oblige. Tandis qu’on est emporté par les développements de cette tragédie mâtinée d’espionnage, on apprend, à l’occasion, à partir de quoi se fabrique le verre, ce qui conditionne sa finesse, sa transparence, ses couleurs…
Venise – plus exactement Murano – , à la fin du XVIIe siècle ; voilà pour le décor et l’époque. L’intrigue, maintenant : une jeune fille – belle et intrépide, comme il sied à une héroïne – dérobe par vengeance à son maître-verrier de père les précieuses formules dont dépend la qualité de ses productions. Il faut dire que l’auguste patriarche avait ordonné à ses trois fils d’assassiner l’amant de sa fille. Rivalité entre familles oblige. Tandis qu’on est emporté par les développements de cette tragédie mâtinée d’espionnage, on apprend, à l’occasion, à partir de quoi se fabrique le verre, ce qui conditionne sa finesse, sa transparence, ses couleurs…
Mais qui limiterait sa lecture à celle d’un thriller historique associant avec brio suspense et érudition commettrait une erreur et se priverait de l’aspect peut-être le plus séduisant du roman. Monnaie de verre est en effet éminemment ludique ; moins par les multiples rebondissements et péripéties que par les références dont le texte regorge. Références qui d’ailleurs vont du simple clin d’œil – tel le titre du premier chapitre, «Arsenic et belles dentelles» – aux mises en abîme plus subtiles ; ainsi les jeux de transparences et d’opacités dont le verre se fait le creuset se transposent-ils aisément dans le texte, où les nombreuses épigraphes, les locutions non traduites en fin de chapitre et les notes font assaut d’ambivalence en offrant des clefs tout en obstruant la lisibilité. Il y a surtout le style, léché à l’extrême, précis, nourri de tournures complexes et de mots rares, longs en bouche, goûteux à souhait ; un style qui ménage, par petites touches ironiques, une distance rédhibitoire entre le narrateur et le texte et, partant, entre celui-ci et le lecteur ; un style aussi qui manie les métaphores brillantes et audacieuses, telle celle appliquée au viol – trois mots dont la puissance est accrue par l’ellipse verbale : «Un autodafé anatomique.»
Enfin, il faut évoquer le joyeux brassage de clichés littéraires qui, mis au service de l’intrigue, n’en sont pas moins déconstruits par l’ironie du ton ou bien les astuces de construction. Ainsi, pour satisfaire aux attendus du polar, l’action commence-t-elle dès la première phrase : «A plusieurs reprises, les trois assaillants plongèrent leur lame dans le corps du malheureux.» Mais cette fracassante entrée en matière se complexifie aussitôt ; le moment de l’agonie est étiré aux dimensions d’un chapitre entier, dilaté à coups d’acrobaties chronologiques insufflant ici et là toutes sortes d’informations qui ancrent le récit dans un contexte à la fois historique et narratif.
Tout concourt donc à rendre impossible une posture de lecture stable : l’on est entraîné de droite et de gauche, bousculé à l’envi dans ses habitudes de lecture. Mais avec, à la clef, cet indicible plaisir de se laisser prendre à un jeu dont on n’est pas tout à fait dupe – sans être certain pour autant de quoi que ce soit…
Le plus bel hommage à Monnaie de verre eût sans doute été un article au énième degré, maniant pour mieux les moquer tous les poncifs de la critique littéraire. Nous nous contenterons de céder à l’un des attendus de celle-ci – sans recul aucun, et avec un enthousiasme pleinement assumé – en invitant les lecteurs à se plonger sans tergiverser dans ce livre tant sa lecture est jubilatoire, hautement jouissive et enrichissante.
Monnaie de verre , Frédéric Grolleau
Titre : Monnaie de verre
Editeur : Nicolas Philippe
Collection :
Année : 2002
Prix indicatif : 19,50 €
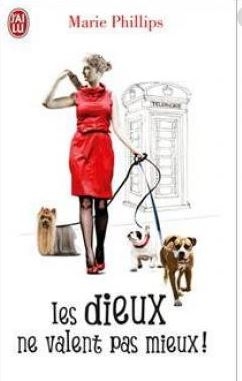 Sur fond de sitcom des dieux de l'olympe, s'invitent en guest-stars les deux tourtereaux, perturbant ainsi le rythme de vie de toutes les divinités, qui se retrouvent alors impliquées dans la plus périlleuse péripétie de leur existence... Apollon, pour se venger de la pauvre Alice qui résiste à sa beauté, finit par réveiller Zeus pour qu'il jette la foudre sur la mortelle. Mais Artémis, qui a compris le sortilège, ne compte pas laisser sa femme de ménage aux griffes de Cerbère, et décide alors d'aller la chercher aux Enfers, avec Neil dans le rôle d'un nouvel Orphée...
Sur fond de sitcom des dieux de l'olympe, s'invitent en guest-stars les deux tourtereaux, perturbant ainsi le rythme de vie de toutes les divinités, qui se retrouvent alors impliquées dans la plus périlleuse péripétie de leur existence... Apollon, pour se venger de la pauvre Alice qui résiste à sa beauté, finit par réveiller Zeus pour qu'il jette la foudre sur la mortelle. Mais Artémis, qui a compris le sortilège, ne compte pas laisser sa femme de ménage aux griffes de Cerbère, et décide alors d'aller la chercher aux Enfers, avec Neil dans le rôle d'un nouvel Orphée... C'est dans cet univers que Knud, un jeune enfant (le narrateur) évolue.
C'est dans cet univers que Knud, un jeune enfant (le narrateur) évolue. 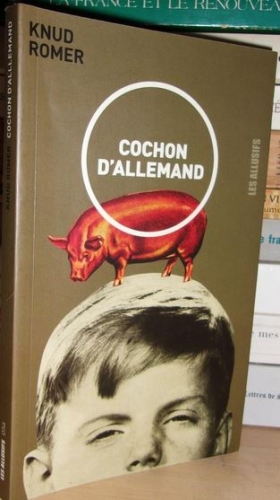 Vu de l'extérieur, on pourrait dire que la famille Romer est une famille normale, qui connaît
Vu de l'extérieur, on pourrait dire que la famille Romer est une famille normale, qui connaît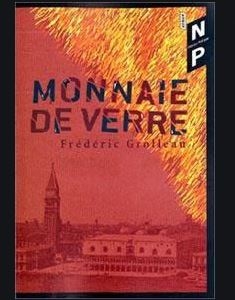 Venise – plus exactement Murano – , à la fin du XVII
Venise – plus exactement Murano – , à la fin du XVII