Ballard, comme beaucoup d'autres écrivains d'anticipation a beaucoup travaillé, dans ses jeunes année surtout, sur l'écologie et le devenir apocalyptique de notre civilisation. On retiendra Sécheresse, roman de 1965, Terrifffiant avec 2 R et au moins 3 F. Ruffin en rêvait, mais c'est Ballard qui l'a fait 20 ans avant.
Ecrivain prolixe, J.G. Ballard n'a jamais cessé d'écrire. Du tournant des années 60 et durant un peu plus d'une cinquantaine d'années, l'observateur dénombrera dans sa copieuse bibliographie, plus de neuf recueils de nouvelles aujourd'hui introuvables en français, en plus de nombreux romans. Souvent réunis sous formes thématiques (c'est le cas de Vermillon Sands, Cauchemar à quatre dimensions ou Les Chasseurs de Vénus) ou de façon plus ou moins aléatoire (Le livre d'or de J.G. Ballard).
Une belle initiative qui permettra au lecteur "Ballardophile" de mettre en perspective ses œuvres de jeunesse avec La Foire aux atrocités, publié par l'éditeur dans sa version définitive il y a un peu plus de deux ans, mais aussi avec Sauvagerie, un court roman de la fin des années 80, dans lequel l'anglais exprime déjà ses obsessions pour le caractère ultra sécuritaire de nos sociétés dites "civilisées". Une réédition de courts récits, qui permet également d'entrevoir le processus de création d'un auteur pour qui "les nouvelles offrent une qualité d'instantané photographique, une capacité à se focaliser intensément sur un seul sujet, qui fournissent le moyen de tester les idées développées dans un roman", comme il le déclare dans sa préface.
La cosmogonie Ballardienne
Au sein de cette vaste cosmogonie thématique, des sujets reviennent de manière plus ou moins récurrente, à la manière d'un canevas d'inspiration existentiel qui infiltre progressivement les romans qui suivront. Ces grands thèmes s'abreuvent vraisemblablement à la source de l'existence peu banale de l'écrivain, enlevé très jeune à la vie civile avec ses parents et interné pendant la guerre en Chine par l'armée japonaise dans un camp de prisonniers (ce qu'il relate notamment dans Empire du Soleil). De retour en Grande Bretagne, l'auteur sera également pilote dans la RAF, et exercera des études de médecine ainsi que divers autres métiers.
Cette existence lui inspirera certainement les réflexions personnelles qui lui feront toujours préférer l'intime, l'intérieur de la psyché humaine aux grands espaces généralement privilégiés par la science-fiction de l'âge d'or. Parmi les thématiques qui feront de Ballard un des piliers de la génération d'écrivains dite "new wave", on trouve justement la guerre, l'enfermement, l'exil, la vie en vase clos... Des thèmes parés par la suite des métaphores science-fictionnesques : projection dans l'avenir, voyage dans le temps, dans l'espace, dans la psyché humaine ou extra-terrestre, futur apocalyptique, etc.
Sublime apocalypse
Cet obsession de la fin du monde ou du moins de la civilisation humaine, est logique venant d'un auteur ayant connu les bouleversements sans précédent d'un des plus violents conflits mondiaux. C'est là la base même de la littérature de Ballard. Son fond de commerce, si l'on ose dire, depuis la fin des années 50. A ce titre, on saluera l'initiative de Denoël qui réédite la fameuse tétralogie apocalyptique de l'auteur britannique. Après Le monde englouti suivi de Sécheresse, c'est au tour de La Forêt de cristal d'avoir les honneurs d'une luxueuse réédition. Plus aboutie que les précédentes, cette fabuleuse description d'un monde en proie à une cristallisation aussi sublime que mortelle dans l'Afrique coloniale des années 60, se lit comme un brillant clin d'œil au mythique voyage Au cœur des ténèbres de Conrad. Ici aussi, l'occidental tout droit débarqué de sa civilisation bien ordonnée et emplie d'idée toutes faites sur ce qu'est la "réalité", se trouve en proie à un monde autre, empli de magie et obéissant à une autre logique, finalement beaucoup plus attirante, même si c'est au prix de sa santé, physique ou mentale, que celle qu'il vient de quitter.
Ballard, ce moraliste
Reste qu'on ne peut nier que ces textes ont quelquefois mal vieilli. Les récits de Ballard sont toujours empreints d'un maniérisme très vieille Europe, jusque dans ses récits censément les plus fantastique ou les plus futuristes. Ses protagonistes, immanquablement des médecins, des avocats, publicitaires ou artistes, quand ce ne sont pas carrément lord et nobliaux, affichent cette sûreté de soit jusqu'aux bouts des ongles, ce "sang froid britannique" tant vanté, jusque dans les situations les plus perturbantes. Le lecteur avide devra donc se frotter à une affectation, un côté précieux parfois agaçant, qui plus est se trouve mêlé à des références culturelles parfaitement snobs et déplacées (voir la musique classique qui berce immanquablement chaque histoire, Ballard dans les années 60 semble être totalement passé à côté du phénomène pop).
On finirait même par se demander si l'auteur n'est pas finalement un moraliste qui, sous couvert d'outrages et de formules choc, ne dépeindra certaines turpitudes par la suite (dans Crash ou La foire aux atrocités, ces deux masterpieces) que pour mieux les dénoncer et s'enfoncer dans un conservatisme et une morale "d'un autre âge"... s'il n'était pas aussi l'un des plus puissants et certainement, ultimes, visionnaires de notre époque.
 L'album présenté ici tranche sur beaucoup d'autres livres et témoignages sur ces "mois des enragés" comme
L'album présenté ici tranche sur beaucoup d'autres livres et témoignages sur ces "mois des enragés" comme 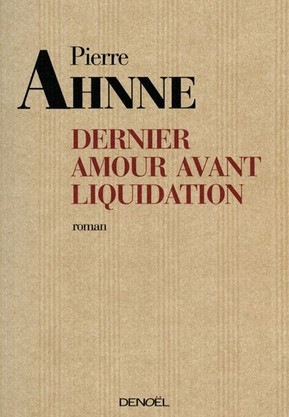 Cinquième roman de
Cinquième roman de 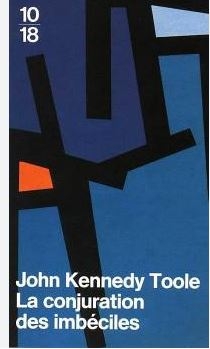 1. La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole
1. La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole