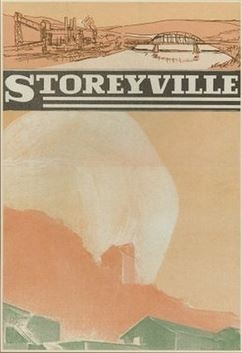
Pittsburgh, Pennsylvanie, capitale du chemin de fer et de la sidérurgie. C'est l'histoire d'un jeune homme, Will, perdu dans sa vie chaotique, entamée au début du XXe siècle. L'horizon grisonne, les cheminées industrielles vomissent du charbon, le grand Will tâtonne : le « Révérend » Rudy, son guide, père spirituel et ami, l'a abandonné. A moins que ce ne soit lui qui l'ait lâchement lâché. (« J'avais perdu un ami, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. ») Lorsqu'il retrouve sa trace, Will abandonne ses arnaques et ses larcins, larguant abruptement les amarres vers le Nord. Adieu Pittsburgh, en route pour Montréal et le Canada, façon railroad novel. On pense aux voyages initiatiques de Kerouac, et plus encore aux aventuriers solitaires de Mark Twain, de R.L. Stevenson, « Americana » de Don Delillo et de Jack London. « Il suffisait juste de trouver le Révérend et de rattraper le temps perdu », souffle le héros, à travers les plaines de l'Ohio. Sporadiquement, la voix du narrateur vient s'accoler sur des paysages bruts, crayonnés au fusain, dessinés à l'encre de Chine ou peints à la gouache, variant de forme et de vitesse selon l'humeur, souvent au sein d'une même planche. Entre liberté jazzy de l'esquisse spontanée (lignes de fuites apparentes, proportions non respectées, narration proche de l'« écriture automatique »), et rigueur implacable du procédé (chacune des 38 pages est quadrillée en 3 x 5 cases de taille identique), l'ouvrage tient son équilibre, notamment grâce à la trichromie (Noir/blanc/ocre) harmonisant ces pages kaléidoscopiques.
D'une audace formelle constante, parfois proche de l'abstraction (les personnages se fondent parfois en motifs cubistes, au gré des doutes du narrateur) cette quête initiatique n'a pas pris une ride. Tandis qu'on adhère à cette bouleversante déclaration d'amitié/paternité, notre regard défile, se perd, happé par le format de l'image autant qu'hypnotisé (aspect sériel) par ce flux romanesque troué d'inserts et de flashbacks inattendus. Maître absolu du paysage en forme de portrait expressionniste et de la fausse improvisation dessinée, Santoro alterne première et troisième personne, jongle entre graphic novel, story-board et roman d'apprentissage, sans jamais s'égarer dans l'exercice de style, conférant à son récit une tension interne proprement sidérante. Un récit qui « coule comme le sang échappé d'une plaie », selon les mots admiratifs de Chris Ware. On n'est pas près d'oublier les retrouvailles de Will et du Révérend Ruby, nouvelles icônes de notre inconscient romanesque et graphique américain, aux côtés de Maus, David Boring et Jimmy Corrigan. Un chef d'œuvre, on vous dit.